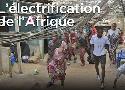952 shaares
47 results
tagged
Géo2nde
En 2021, l’Ethiopie est le pays qui a dénombré le plus de familles fuyant leur foyer, décrypte Ivana Hajzmanova, coordinatrice de l’ONG Internal Displacement Monitoring Center.
Les pays les plus pauvres sont aussi ceux qui sont les plus touchés par les risques naturels : incendies, sécheresse, inondations... Ces derniers se sont multipliés et intensifiés ces dernières années en raison du dérèglement climatique. Comment faire face à ces enjeux climatiques majeurs ?
En 2018, la métropole du Cap, en Afrique du Sud, a échappé de peu à la catastrophe. Trois ans de sécheresse avaient vidé les barrages qui alimentent la ville en eau. Pour y faire face, les habitants ont dû drastiquement revoir leur quotidien et réévaluer leur consommation, à la goutte près.
Les restrictions, graduellement durcies pour limiter la consommation d’eau à 50 litres par jour par personne, ont obligé les Capétoniens à redéfinir radicalement leur rapport à l’eau et la municipalité à se préparer aux futures sécheresses que les experts annoncent plus fréquentes et plus longues.
En 2020, la ville a revu sa gestion de l’eau avec pour objectif de produire 300 millions de litres d’eau supplémentaires en 2030 et 250 millions en 2040. Des volumes qui s’ajouteront aux 900 millions de litres déjà fournis. Elle entend le faire en diversifiant ses sources d’approvisionnement : dessalement d’eau de mer ; captation d’eaux souterraines ; recyclage direct des eaux usées. Le Monde Afrique est allé à la rencontre des acteurs de cette stratégie pour voir les premiers projets sortis de terre.
Les restrictions, graduellement durcies pour limiter la consommation d’eau à 50 litres par jour par personne, ont obligé les Capétoniens à redéfinir radicalement leur rapport à l’eau et la municipalité à se préparer aux futures sécheresses que les experts annoncent plus fréquentes et plus longues.
En 2020, la ville a revu sa gestion de l’eau avec pour objectif de produire 300 millions de litres d’eau supplémentaires en 2030 et 250 millions en 2040. Des volumes qui s’ajouteront aux 900 millions de litres déjà fournis. Elle entend le faire en diversifiant ses sources d’approvisionnement : dessalement d’eau de mer ; captation d’eaux souterraines ; recyclage direct des eaux usées. Le Monde Afrique est allé à la rencontre des acteurs de cette stratégie pour voir les premiers projets sortis de terre.
Histoire et enjeux du commerce du cacao décryptés par “Le dessous des cartes”. Et zoom sur une économie du chocolat profondément inégalitaire. La mondialisation du chocolat est marquée par de fortes disparités entre pays producteurs du sud et pays consommateurs, principalement au nord. Le commerce du cacao est un commerce asymétrique entre grandes multinationales qui contrôlent l’ensemble de la chaîne de valeurs et petits producteurs. Mais la donne est peut-être en train de changer grâce à des initiatives africaines qui se font avec la complicité de la Chine.
Originaire d’Amérique du Sud, le cacao des Mayas et des Aztèques s’implante ensuite en Afrique avec les colons européens.
Aujourd’hui, la fringale de chocolat est mondiale et ne met plus seulement en appétit l’occident, car même la Chine et l’Inde en découvrent la saveur. Un engouement qui ne profite pas suffisamment aux deux principaux pays producteurs : la Côte d’Ivoire et le Ghana.
#HistoireCacao #CoteDivoireCacao #Chocolat
Originaire d’Amérique du Sud, le cacao des Mayas et des Aztèques s’implante ensuite en Afrique avec les colons européens.
Aujourd’hui, la fringale de chocolat est mondiale et ne met plus seulement en appétit l’occident, car même la Chine et l’Inde en découvrent la saveur. Un engouement qui ne profite pas suffisamment aux deux principaux pays producteurs : la Côte d’Ivoire et le Ghana.
#HistoireCacao #CoteDivoireCacao #Chocolat
Ce titre est une allusion au livre intitulé Une vie pleine de trous qui eut un certain retentissement en 1965, faisant découvrir la vie d’un migrant intérieur venu de la campagne du Rif à Tanger. Un jeune Marocain, Driss ben Hamed Charhadi, raconte sa vie pleine de trous à Paul Bowles, le visiteur immobile du Sahara de la psyché qui, après l’avoir enregistré au magnétophone, a traduit ce récit en anglais. À travers la naïveté du discours de Charhadi apparaissent la misère de sa famille, les quelques jours heureux passés à l’orphelinat, la précarité des emplois et l’éternelle recherche de travail, le chômage, la prison, les aventures sentimentales … Tanger, gare de triage de tous les exils1, reste cette enclave internationale où les riches du Nord tentent de poursuivre la quête exotique2 de Paul Bowles3, tandis que les pauvres du monde veulent franchir le détroit qui sépare l’Afrique de l’Europe. Tanger est la proue du continent africain mais dissimule derrière son décor hybride d’arabisme post-colonial et de modernité industrielle les discontinuités, les béances et les dissidences de ses villes masquées.
Les données calculées par le géographe de la santé Emmanuel Vigneron mettent en évidence une France divisée sur le plan de la vaccination entre Nord-Ouest et Sud-Est, entre centres urbains et périphéries, ainsi qu’entre communes riches et pauvres.
Pour la première fois depuis la conquête de ce territoire, l’aridité dans le bassin du Colorado menace la production hydroélectrique, l’agriculture et certaines industries.
« Zone brûlée ». A l’embranchement de la route 14, un panneau barre la circulation. La forêt est interdite « à tous les usagers ». En ce mois de juillet, on ne peut pas accéder à la source du Colorado, au lac du col de la Poudre. C’est de là que s’élance le grand fleuve de l’Ouest américain, à 3 100 m d’altitude, à l’ombre des Never Summer Mountains, les montagnes qui ne voient jamais l’été. D’habitude, c’est une destination prisée des randonneurs. Mais le paysage est aujourd’hui défiguré...
« Zone brûlée ». A l’embranchement de la route 14, un panneau barre la circulation. La forêt est interdite « à tous les usagers ». En ce mois de juillet, on ne peut pas accéder à la source du Colorado, au lac du col de la Poudre. C’est de là que s’élance le grand fleuve de l’Ouest américain, à 3 100 m d’altitude, à l’ombre des Never Summer Mountains, les montagnes qui ne voient jamais l’été. D’habitude, c’est une destination prisée des randonneurs. Mais le paysage est aujourd’hui défiguré...
🌡🌪Le dérèglement climatique est trop souvent perçu dans les pays du Nord comme une échéance certes redoutable, mais lointaine. Pourtant, il change d’ores et déjà la vie quotidienne de millions d'êtres humains : fonte des glaces, inondations, incendies géants, tempêtes dévastatrices, sécheresses, épisodes caniculaires... Un tour du monde des populations et des paysages qui subissent déjà très concrètement et durement ses conséquences.
Notre glossaire propose plusieurs nouvelles entrées pour réfléchir à la notion centrale du programme de seconde : transition.
Selon une étude néerlandaise, le trait de côte pourrait fortement reculer d’ici la fin du siècle en raison notamment de la crise climatique.
La limite entre terre et mer est mobile par nature. Les marées, les vents, les tempêtes font varier cette ligne appelée trait de côte. Mais sous l’effet du changement climatique, la mer pourrait petit à petit gagner du terrain, selon un rapport publié dans la revue Scientific Reports, mercredi 7 juillet. Cette étude, pilotée par l’université de Twente aux Pays-Bas, se penche sur l’évolution des traits de côte de 41 embouchures de fleuve à travers le monde, dont celles de la Gironde et de la Loire, d’ici à la fin du siècle.
La limite entre terre et mer est mobile par nature. Les marées, les vents, les tempêtes font varier cette ligne appelée trait de côte. Mais sous l’effet du changement climatique, la mer pourrait petit à petit gagner du terrain, selon un rapport publié dans la revue Scientific Reports, mercredi 7 juillet. Cette étude, pilotée par l’université de Twente aux Pays-Bas, se penche sur l’évolution des traits de côte de 41 embouchures de fleuve à travers le monde, dont celles de la Gironde et de la Loire, d’ici à la fin du siècle.
A l’est de Cotonou, d’immenses épis ont permis de faire reculer l’océan et d’assurer la sécurité des riverains.
L’océan a fini par reculer. De 150 mètres en moyenne, 180 mètres par endroits. A l’est de Cotonou, capitale économique du Bénin, une longue plage de sable fin s’étire maintenant sur une quinzaine de kilomètres le long de la route qui mène vers le Nigeria...
L’océan a fini par reculer. De 150 mètres en moyenne, 180 mètres par endroits. A l’est de Cotonou, capitale économique du Bénin, une longue plage de sable fin s’étire maintenant sur une quinzaine de kilomètres le long de la route qui mène vers le Nigeria...
REPORTAGE - La construction par l’Ethiopie d’un gigantesque ouvrage inquiète, en aval, le Soudan et l’Egypte, dépendants du fleuve africain et inquiets des futurs choix d’Addis-Abeba. Le Conseil de sécurité de l’ONU doit débattre, jeudi, d’une dispute qui menace de déstabiliser la Corne de l’Afrique.
Leur position stratégique en bord de mer a fait d’elles des fleurons mondiaux du commerce et de la culture… Les villes côtières sont désormais menacées par l’océan qui avait permis leur essor, sous l’effet du réchauffement.
De Venise à Dacca, les villes côtières et leurs millions d'habitants installés sur le littoral sont "en première ligne" de la crise climatique qui risque de redessiner les cartes des continents, s'inquiète un projet de rapport des experts climat de l'ONU (Giec) obtenu en exclusivité par l'AFP.
Le Brésil maîtrise-t-il (enfin) la déforestation en Amazonie ?
Depuis une dizaine d’années, les surfaces déforestées en Amazonie diminuent chaque année et le déboisement en 2014 a représenté moins de 20 % de celui de 2004. Doit-on en déduire que le Brésil maîtrise désormais le phénomène de déforestation ? Répondre à cette question implique d’exposer la complexité du phénomène de déforestation. Celui-ci possède en effet de nombreuses dimensions : économique (qui défriche, pour gagner quoi ?), sociale (question de l’accès à la terre, conflits fonciers), environnementale (impacts sur le climat, effets locaux, biodiversité) et même géopolitique (rôle du Brésil sur la scène mondiale, négociations sur les émissions…). La taille de la région considérée est un autre élément de complexité car les facteurs en jeu ne sont pas uniformes. Malgré ces difficultés, nous proposons ici une synthèse des principales questions liées à l'enjeu du déboisement. Nous abordons dans un premier temps l’historique du phénomène, sa répartition géographique et ses conséquences. Nous nous intéressons ensuite à ses causes et à ses acteurs. Enfin, nous présenterons les actions menées depuis dix ans par le gouvernement fédéral brésilien pour le maîtriser. La conclusion sera l’occasion de réfléchir sur les limites des politiques actuelles et sur les défis qui restent à relever.
Depuis une dizaine d’années, les surfaces déforestées en Amazonie diminuent chaque année et le déboisement en 2014 a représenté moins de 20 % de celui de 2004. Doit-on en déduire que le Brésil maîtrise désormais le phénomène de déforestation ? Répondre à cette question implique d’exposer la complexité du phénomène de déforestation. Celui-ci possède en effet de nombreuses dimensions : économique (qui défriche, pour gagner quoi ?), sociale (question de l’accès à la terre, conflits fonciers), environnementale (impacts sur le climat, effets locaux, biodiversité) et même géopolitique (rôle du Brésil sur la scène mondiale, négociations sur les émissions…). La taille de la région considérée est un autre élément de complexité car les facteurs en jeu ne sont pas uniformes. Malgré ces difficultés, nous proposons ici une synthèse des principales questions liées à l'enjeu du déboisement. Nous abordons dans un premier temps l’historique du phénomène, sa répartition géographique et ses conséquences. Nous nous intéressons ensuite à ses causes et à ses acteurs. Enfin, nous présenterons les actions menées depuis dix ans par le gouvernement fédéral brésilien pour le maîtriser. La conclusion sera l’occasion de réfléchir sur les limites des politiques actuelles et sur les défis qui restent à relever.
Une étude quantifie pour la première fois les micropolluants rejetés par les stations d’épuration en France
Près de 147 tonnes de résidus de médicaments, de pesticides et métaux seraient renvoyées chaque année dans l’environnement une fois les eaux usées traitées, selon une étude.
Près de 147 tonnes de résidus de médicaments, de pesticides et métaux seraient renvoyées chaque année dans l’environnement une fois les eaux usées traitées, selon une étude.
La révolution verte voulue par les pays de l’Union est complètement dépendante de la production de matériaux rares centralisée dans un tout petit nombre de pays du globe : les derniers chiffres publiés par la Commission européenne doivent nous alerter.
Pour les plus optimistes, le chantier abyssal de l’électrification du continent africain pourrait sauter l’étape des lignes électriques, en passant directement à la téléphonie mobile et aux énergies renouvelables. En attendant, les inégalités d’accès à l’électricité, comme l’incapacité des États à assurer cette mission de service public, demeurent flagrantes.
Survolant le continent, “Le Dessous des cartes” constate que l’électrification progresse lentement, et que l’Afrique subsaharienne semble rester inexorablement dans l’ombre. #Afrique #AfriqueSubsaharienneElectricite #AfriqueElectrification
- Nous vous conseillons la lecture de plusieurs articles de la revue “Jeune Afrique” consacrés au marché électrique du continent africain ainsi qu'à différents projets d'amélioration.
http://bit.ly/JeuneAfriqueElectricite
- “La start-up africaine de la semaine : Baobab+, des kits solaires aux tablettes éducatives”
http://bit.ly/JeuneAfriqueKitSolaire
- Revue de l'IFRI “Gestion des déchets et production d’électricité en Afrique : l’incinération au service de la ville durable ?” par Hugo Le Picard
http://bit.ly/IfriAfrique
Survolant le continent, “Le Dessous des cartes” constate que l’électrification progresse lentement, et que l’Afrique subsaharienne semble rester inexorablement dans l’ombre. #Afrique #AfriqueSubsaharienneElectricite #AfriqueElectrification
- Nous vous conseillons la lecture de plusieurs articles de la revue “Jeune Afrique” consacrés au marché électrique du continent africain ainsi qu'à différents projets d'amélioration.
http://bit.ly/JeuneAfriqueElectricite
- “La start-up africaine de la semaine : Baobab+, des kits solaires aux tablettes éducatives”
http://bit.ly/JeuneAfriqueKitSolaire
- Revue de l'IFRI “Gestion des déchets et production d’électricité en Afrique : l’incinération au service de la ville durable ?” par Hugo Le Picard
http://bit.ly/IfriAfrique
Long de près de 5 000 kilomètres, le Mékong traverse six États, tous soucieux de tirer parti de cette ressource majeure pour leurs populations et leur économie. Quel est l’apport du Mékong et comment ces États se le partagent-ils ? Le dessous des cartes se penche sur les enjeux qui entourent l’un des plus grands fleuves d’Asie. 2015.